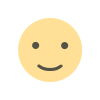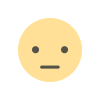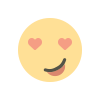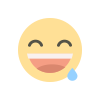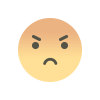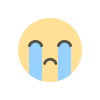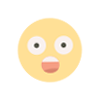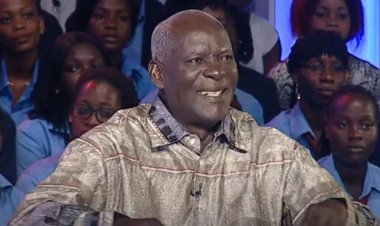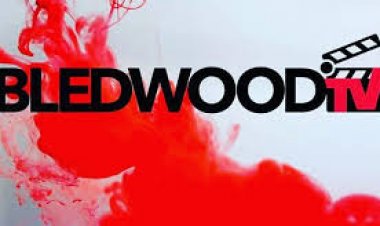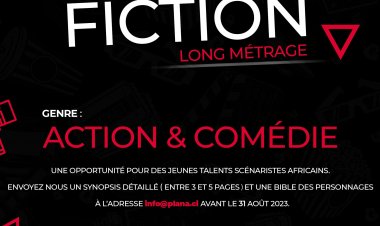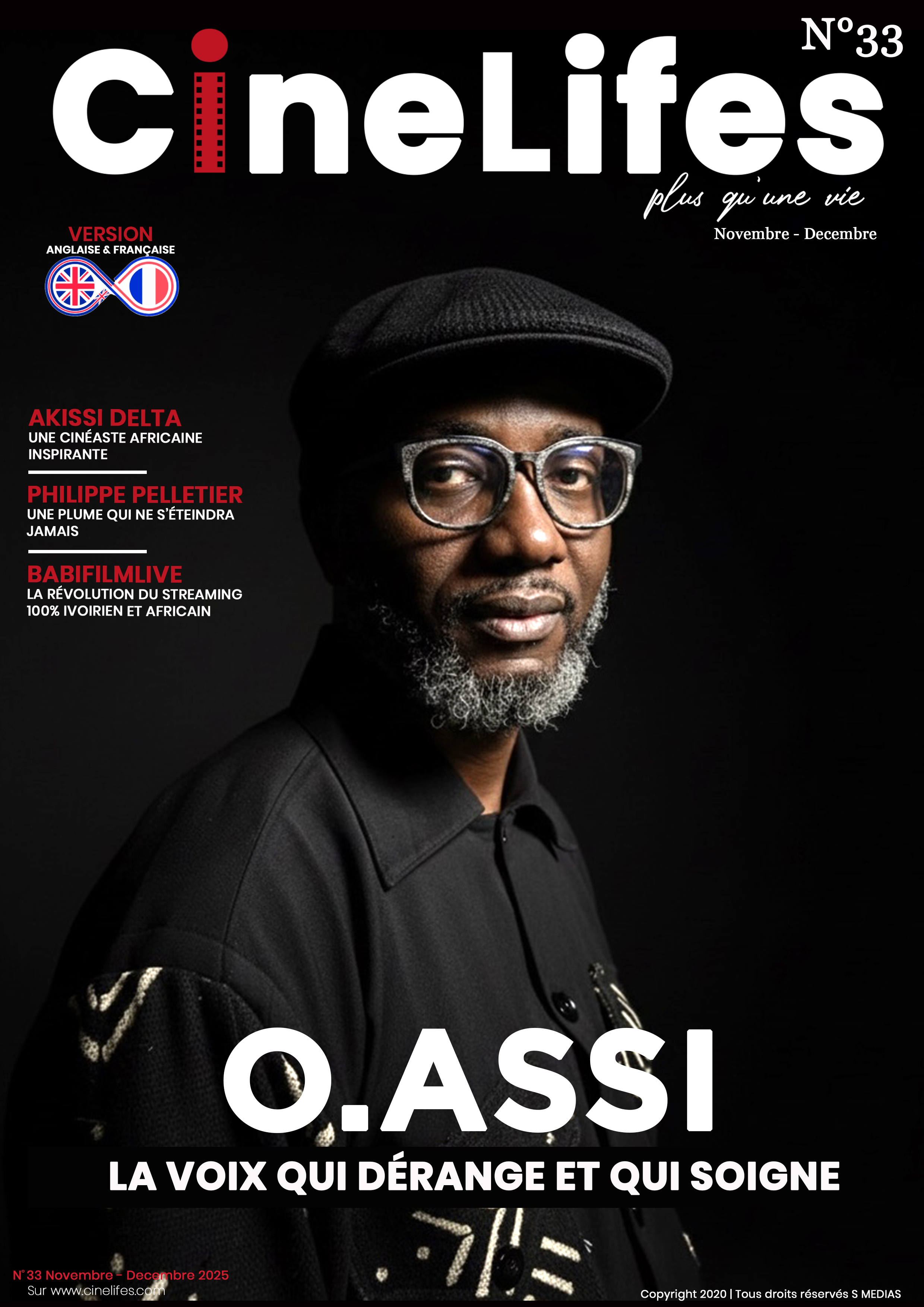Homosexualité dans le cinéma africain : entre silence, peur et rejet… Jusqu’à quand le tabou ?

Le cinéma africain, souvent acclamé comme le miroir de nos sociétés, se veut le reflet fidèle de nos réalités, de nos traditions et de nos luttes. Pourtant, il semble encore s’incliner devant l’un des tabous les plus persistants de notre époque : la question de l’homosexualité.
Alors qu'en Occident, les personnages et les thématiques LGBTQ+ s’imposent peu à peu dans les scénarios et sur les écrans, en Afrique, le silence demeure lourd, presque institutionnel. Ce mutisme cinématographique interroge la profondeur de notre engagement à raconter toutes les histoires.
La prudence ne se limite pas aux sujets abordés. Elle s'étend aux plateaux. Dans de nombreux castings à travers le continent, des acteurs ou actrices ouvertement homosexuels sont écartés, souvent sans explication claire.
La peur est palpable chez certains producteurs : « On ne veut pas de problème avec le public », dit-on, craignant le boycott, la censure, ou la perte de financement. Le résultat est brutal : le talent se voit refuser l’espace qu’il mérite, non pour son niveau de jeu, mais pour sa différence. Le cinéma africain, qui a tant besoin de ses meilleurs artistes, se prive lui-même d’une partie de sa force créatrice.
Le paradoxe est d’autant plus frappant que le cinéma africain se bat pour raconter des histoires vraies, dénoncer l’injustice, la pauvreté ou la corruption. Pourtant, il reste étrangement muet face à la réalité de l’homosexualité.
Pourquoi ce blocage ? Est-ce la peur de choquer ? La crainte de perdre un public majoritairement conservateur ? Ou simplement un conformisme culturel qui étouffe l’audace ? Le rôle de l'art n’est-il pas précisément de questionner la société, même dans ses tabous les plus profonds, et d'éclairer les zones d'ombre ? En se taisant, le cinéma choisit d'être un miroir sélectif.
L’Afrique est en pleine mutation. Les jeunes générations s’expriment, les réseaux sociaux bousculent les normes, et les voix LGBTQ+ refusent de rester invisibles. Mais le cinéma, lui, avance à pas lents.
Les rares films qui osent aborder la question, comme Rafiki (Kenya) ou Stories of Our Lives, ont été systématiquement censurés, interdits ou fortement critiqués dans leurs pays d’origine. Pourtant, ces œuvres ont voyagé, ému les festivals internationaux, et prouvé qu'elles avaient une résonance bien au-delà des frontières. Ces succès extérieurs sont la preuve que le refus d’intégrer ces récits ne protège pas la culture africaine il la prive d’un débat nécessaire et d’une évolution artistique authentique.
Et si l’Afrique osait enfin raconter toutes ses réalités, sans peur ni jugement ? Et si les producteurs comprenaient qu’intégrer et représenter ne signifie pas promouvoir, mais simplement reconnaître l’existence de millions de personnes ?
La vitalité du cinéma africain est à ce prix : celui de l'authenticité et du courage.